14/11/2012
L'amour au creuset des mots
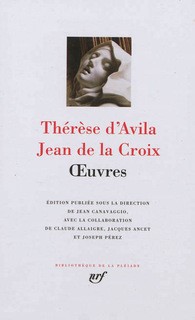 Thérèse d’Avila et Jean de la Croix entrent dans la collection de la Pléiade. L’écriture puissante et suggestive des deux mystiques fut tout entière dédiée à célébrer l’amour divin.
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix entrent dans la collection de la Pléiade. L’écriture puissante et suggestive des deux mystiques fut tout entière dédiée à célébrer l’amour divin.Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, ces deux noms, souvent associés par l’amitié qui les unit, font forte impression. Réformateurs, mystiques, saints et docteurs de l’Église, leurs titres se conjuguent pour sidérer qui s’approche à l’orée de leurs œuvres. Pourtant, rien ne fut plus étranger à leur intention que de semer le trouble. Car si Thérèse et Jean se résolurent à écrire, ce fut avant tout pour partager la saveur d’un amour.
Il faut faire confiance à ce dessein, et on se surprendra à entendre résonner leurs textes, malgré la distance qui sépare du XVIe espagnol. Sans doute est-ce le signe que les deux mystiques furent, aussi, de vrais écrivains. La sélection de textes qui vient de paraître dans la collection de la Pléiade, chez Gallimard, permet d’en prendre toute la mesure. Elle s’ouvre sur le récit autobiographique de Thérèse d’Avila, le Livre de la vie, où la religieuse se dévoile sans détour; elle se clôt dans la poésie somptueuse de Jean de la Croix. Deux styles, deux étoffes chatoyantes, qui encadrent des textes plus ardus, comme Le Château intérieur ou les Demeures de l’âme.
Rédigé à la demande de ses supérieurs alors que Thérèse fait face aux soupçons de l’Inquisition, le Livre de la vie raconte la maturation de sa vie spirituelle. Dans la lignée des Confessions de saint Augustin, dont la lecture l’avait fortement impressionnée – «Je crus m’y reconnaître», écrit-elle –, la religieuse raconte son chemin de foi, ses hésitations et ses joies, le ponctuant de louanges à Dieu. Le style est franc et vigoureux. Le témoignage, simple et fraternel.
À la lire, on croirait entendre la confidence de vive voix. On imagine Thérèse enfant, qui s’invente des jeux, où elle vit le martyre en mourant sous les coups des Maures, se fait ermite… Autre temps, autres mœurs! L’enfance heureuse, auprès de parents bons et fervents – «Voir mes parents n’aimer rien que les vertus m’était une aide. Les leurs étaient nombreuses» – va bientôt se transformer en une jeunesse plus indolente. Thérèse est belle, intelligente, rayonnante. Elle est sûre de ses charmes. Il faudra qu’elle soit placée, par prudence, au couvent pour qu’elle renoue avec le désir de son enfance: se faire religieuse.
L’entrée dans les ordres fut malgré tout un arrachement, comme en témoigne la description poignante qu’elle donne de son départ de la maison familiale. «Telle fut ma douleur, le jour où je quittai la demeure de mon père, que je ne pense pas, à l’heure de ma mort, en ressentir de plus cruelle : on eût dit que chacun de mes os se séparait des autres.» De ce sacrifice librement consenti, renouvelé au fil des jours et des années, naîtra l’un des itinéraires les plus exceptionnels de l’histoire du christianisme.
Dans ses écrits, Thérèse s’efforce de partager le cœur de sa vie spirituelle: l’oraison. Dans le Livre de la vie, elle utilise pour cela la métaphore du jardin : «Le débutant doit s’imaginer qu’il se met à faire un jardin sur un terrain très ingrat et plein de mauvaises herbes, afin que le Seigneur s’y délecte.» Dans Le Château intérieur, le parcours de l’âme qui aspire à s’unir à Dieu est décrit comme un passage par sept demeures. Dans la dernière s’accomplit le «mariage spirituel», l’union parfaite avec Dieu, «où deux choses séparées ne font plus qu’une», ce moment où «on ne sent plus rien, mais on jouit sans comprendre ce dont on jouit» .
Thérèse, qui connaît toute sorte de phénomènes extatiques, n’en garde pas moins les pieds sur terre. On le voit à la lecture du Livre des fondations, où elle apparaît en réformatrice de l’ordre du Carmel. Pragmatique, efficace, endurante. Entre 1567 et 1582, pendant les quinze dernières années de sa vie, la religieuse va fonder 15 couvents, qui renouent avec l’esprit de pauvreté et de prière de la règle originelle, non sans susciter de fortes résistances.
Active et contemplative, Marthe et Marie, la religieuse sait aussi se moquer d’elle-même, de ses ardeurs comme de ses tiédeurs, de sa volonté de convertir les autres à l’oraison. Elle critique les «sottes dévotions», se méfie des bonnes intentions – «si je devais dire toutes les erreurs que j’ai vu commettre quand on se fie aux bonnes intentions, je n’en finirais pas», lâche-t-elle. Plus que tout, celle qui souffrit tant d’être mal conseillée, redit sans relâche l’importance d’un maître avisé, expérimenté et docte.
C’est en la personne de Jean de la Croix, on le sait, qu’elle finit par trouver ce secours. Né en 1542, il fit partie du premier monastère réformé masculin et s’imposa bientôt comme l’un des piliers du renouveau religieux initié par Thérèse. Une collaboration confiante et une amitié réciproque les unirent. Ces deux êtres brûlaient du même feu.
Mieux formé, plus instruit, Jean de la Croix va traduire la passion divine dans une poésie subtile, qui le place parmi les maîtres de la langue espagnole. L’âme en quête de Dieu y prend les traits de l’amoureuse à la recherche de son amant, comme dans le Cantique des Cantiques. Tout chante la suavité de l’amour et la douleur d’être encore séparés. À l’une de ses disciples, qui lui demandait un jour si c’était Dieu qui lui donnait ces mots, Jean de la Croix eut cette réponse : «Parfois c’était Dieu qui me les donnait, parfois c’était moi qui les cherchais.» Subtile réponse où l’écriture elle-même devient une métaphore de l’amour.
ÉLODIE MAUROT (La Croix)
00:00 Publié dans Livres, Réflexions spirituelles | Lien permanent | Commentaires (0)



















Les commentaires sont fermés.